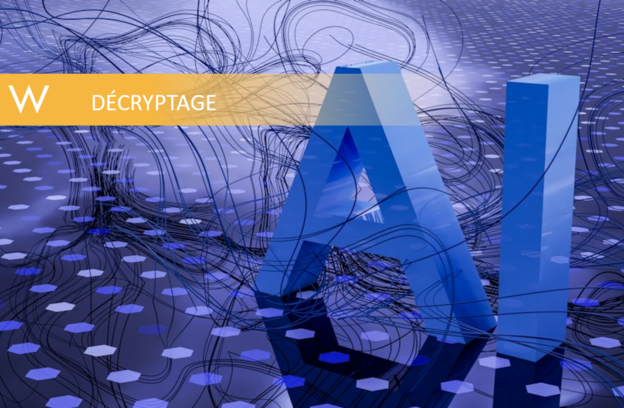Quelle que soit notre situation et notre état, nous partageons tous un destin commun et un temps partagé. En cela nous nous situons en permanence à la croisée du rapport entre le temps individuel et collectif.
Le temps fait partie intégrante de notre vie quotidienne, quel que soit notre état, il est là, à la fois, omniprésent et immatériel, et ce même si en fonction de nos activités, de nos âges, de nos cultures et religions nous ne l’habitons pas de la même façon. Que nous en fassions un usage sporadique, haché ou parfois planifié, il affirme toujours sa présence en nous, au sein de notre cerveau, véritable machine à traiter le temps et analyser les évènements, et ce même si là encore nos vécus du temps évoluent profondément au cours de nos vies. Pourtant, alors que la perception de la vue, du toucher, de l’ouïe, de l’odorat, du goût met en jeu des récepteurs sensoriels spécialisés, curieusement il n’existe aucun récepteur spécifique du temps. A croire que ce dernier n’a d’existence que dans notre perception subjective ou chronométrique. Juger correctement le temps demande donc non seulement de lui prêter attention, mais aussi de conserver en mémoire le flux de l’information temporelle qu’il charrie, puisque la perception de celui-ci par le cerveau repose exclusivement sur des processus liés à la mémoire et à l’attention.
Pour preuve de ce processus : la sensation que le temps passe plus vite si on est très occupé, qu’on s’adonne à une activité passionnante ou ludique. En effet, sous l’effet des émotions, le temps perçu nous semble plus court ou plus long qu’il ne l’est en réalité. C’est bien là toute la différence entre le temps perçu par notre cerveau – temps subjectif – et le temps rythmé par le tic-tac de notre montre – temps objectif -, et là encore la notion d’horloge interne n’est qu’une métaphore, car non plausible sur les plans neurophysiologique et neuroanatomique. Ce temps qui passe est donc une valeur immuable, ni stockable, ni appropriable, aussi volatil que précieux et totalement indifférent à nos désirs. Nos sociétés post modernes et mercantilistes, pas plus que les précédentes, ne maîtrisent l’intelligence du temps, même si elles ont une prise en compte de plus en plus intense de celui-ci, et de sa présence. D’ailleurs, à défaut de le penser elles le quantifient perpétuellement et le qualifient avec toujours plus de précision pour mieux le vendre : « Temps libre, temps de loisir, temps de formation,… ». Pour Marc Aurèle, d’ailleurs, le temps constitue la seule valeur jamais dépréciée, car c’est là le prix que nous devons payer en toute circonstance.
Simultanément, l’effacement croissant des arrières plans historiques et des visions de l’avenir est devenu, pour nombre d’observateurs, préoccupant. En effet, alors que nos temporalités sont devenues de plus en plus disparates, nous sommes traversés par la difficile articulation du court terme et du long terme qui symbolise le contraste permanent de l’urgence et de l’horizon. Mais ce morcellement du temps, c’est aussi ce qui nous autorise une perception de celui-ci par une géographie intérieure sans cesse réaménagée et renégociée à l’aune de nos affects. Ces télescopages du temps, c’est enfin le désordre du temps postmoderne, c’est à dire de cet espace temporel sans cesse bouleversé. En fait, ce serait comme s’il arrivait quelque chose au temps, du moins à notre représentation de celui-ci et à nos manières de le vivre. Car le temps de l’univers, comme nous le savons, est bien sûr toujours le même. Tandis qu’émerge dans nos sociétés une standardisation des modes de vie et de nos approches du temps, il s’agit de comprendre comment se modifient, sous la pression et la concentration des évènements, les relations entre nous, mais aussi à l’égard des événements, sous l’effet combiné de l’accélération des rythmes de vie, de la conviction dominante que tout doit aller vite, du morcellement de nos instants et de nos activités, sans oublier la perte des lointains, et l’avenir qui devient flou.
Nous sommes dès lors confrontés au choc des temporalités, notamment quand il faut gérer les urgences, puisque gérer le temps c’est gérer la dissociation des objectifs. Notre quotidien est d’ailleurs marqué par cette prégnance du temps, qu’il soit court ou long. En effet, au fil des jours, par la rationalisation de notre « emploi du temps », avons-nous « gagné du temps » ou en avons-nous « perdu » ? Tout cela est bien curieusement posé et bien subjectif, puisque tout dépend en effet de ce qu’on « fait du temps »: on en « profite », ou on « le gâche »… Toutes ces expressions sont si banales d’ailleurs qu’on en a perdu leur sens, oubliant par la même occasion que le problème ne vient pas du manque de temps, mais plutôt d’une mauvaise gestion de celui-ci. Quand il est disponible, comment doit-on l’utiliser, alors qu’il est rare et compté ?
Alors que nous sommes confrontés à un présent envahissant, présenté comme le seul horizon possible et se convertissant à chaque instant dans l’immédiateté, il nous faut impérativement réconcilier le court terme et le long terme, car le temps est un élément de structuration non seulement de notre psyché, mais aussi de la société et de toutes les superstructures qui la composent et l’englobent. Dans ce maelström perpétuel des activités qui s’accumulent et s’enchaînent, où un événement chasse l’autre, l’impératif devient alors d’être réactif, toujours plus mobile, flexible, c’est à dire plus rapide. Ce temps immédiat marqué par le temps des flux, de l’accélération et une mobilité valorisée et valorisante, souligne les risques et les conséquences d’un présent omniprésent, omnipotent, s’imposant comme seul horizon possible, voire des possibles. Nous sommes, dès lors, complètement concentrés sur des réponses immédiates à l’immédiat. Il faut réagir en temps réel, voire être proactif jusqu’à la caricature dans le cas de la communication politique. Les réunions doivent être de courte durée, les travaux des comités de direction de plus en plus concis et synthétiques, les restitutions fortement réduites, car il convient alors de passer à l’action sans délai. Nous vivons bien là dans l’obsession du court terme, acharnés à gagner du temps, à réduire la durée de toute opération, comme si nous voulions écraser le temps et nier ce que Bergson appelait « la durée concrète ». Survalorisation du temps court, voracité de cet espace temporel phagocyté par l’instant, les yeux sont fixés sur l’immédiat et nous voilà concentrés sur celui-ci jusqu’au grotesque.
Nous sommes en effet étrangement soumis aux instruments du présentisme : email, SMS, Tweet, tout semble calculé et pensé à l’aune du court terme. Le temps aléatoire se développe alors, le temps précipité l’emporte, c’est le temps de la mondialisation, de l’interconnexion et de la globalisation, c’est à dire celui où chacun dépend de tous en temps zéro. Vivre le “ résentisme”, c’est dès lors être cloué au temps présent sans être capable de le vivre. Nous voilà alors de plain-pied dans le temps vibrionnaire, dominé par les média où la théâtralisation et la dramatisation l’emportent et dominent. Confrontés à la médiatisation de l’évènement, le temps de la réflexion est alors consommé par celui de la communication et de son dictat, puisque “l’évènement qui n’a pas été publié ne s’est pas produit”.
Même si cette intensification des rythmes n’est pas universelle, face à la pression de ce temps qui court, il est urgent d’ajuster les modalités de la prise de la décision. Il appartient alors de se libérer et de se dégager de cette obligation de réactivité immédiate aux sollicitations du temps bref, pour s’échapper d’une logique de l’immédiat et s’engager dans la durée. Cette exigence nécessite, pour des décideurs publics et privés, certes une grande capacité d’extraction et de recul, mais aussi une extrême agilité pour gérer les oscillations permanentes entre des exigences différentes voire opposées entre le court terme et le long terme. En tout état de cause, il ne faut pas que le prima de l’action fasse passer au second plan la réflexion et la conception propre au temps long. Il nous faut donc combattre la tyrannie de l’instant pour se redonner des marges de manœuvre.
Nous le savons, pour l’avoir expérimenté, dans la vie de la nation, le temps court est trop souvent l’ennemi des reformes utiles et courageuses, alors que parallèlement, le temps long est prisonnier des calendriers politiques et des séquences électorales. En effet, nos sociétés de l’immédiat exigent des résultats sans tarder, et l’on veut récolter tout de suite, mais on ne laisse pas mûrir. Or, à côté de ces temps courts, il faut pouvoir aménager des temps longs, propre à la maturation, aux infléchissements discrets, qui sont seuls porteurs d’améliorations effectives et profondes. Dans ces conditions, dans notre culture marquée par la suprématie de l’action, le défi n’est pas d’aller encore plus vite mais, pour communiquer et réfléchir, de s’arrêter plus fréquemment pour penser l’action plus longuement, considérant que, pour prendre de bonnes décisions, se donner du temps est incontournable. Les principes fondamentaux de la fiabilité de la décision reposent donc sur la durée qui elle-même intègre le débat contradictoire et donc exige du temps, notamment celui d’écouter l’avocat du diable et le candide. De même, la pratique du débriefing doit être généralisée. Alors que dans certains milieux elle est systématiquement pratiquée – c’est le cas notamment dans l’aéronautique –, elle est loin d’être reconnue dans bien des structures de direction. Trop souvent alors, des événements riches d’enseignements et d’orientations nouvelles sont aussitôt oubliés pour replonger immédiatement dans l’action.
Malgré tout, il existe pourtant aussi des « entre temps”, tout aussi déterminants, c’est à dire des phases de transition, ce que Platon nomme “des soudains hors du temps”. Si difficile à penser et à appréhender qu’ils soient, ce sont pourtant autant de “transformations silencieuses”, que nous négligeons si souvent. C’est pourtant tout ce qui trace sa route sans bruit, ce qui chemine dans la discrétion, dans la globalité et la continuité du temps, ce qui ne se démarque jamais suffisamment pour qu’on le repère et puisse penser clairement un “ avant ” et un “ après ”, sans manifestations sonores susceptibles de capter l’attention des médias. Il convient, dès lors, de cesser de considérer le temps de la décision comme l’instant, où tout se tranche, alors qu’il s’agit davantage d’un temps d’inclinaison progressif, qu’un instant qui se dit. Il faut donc se réapproprier ce cheminement de la décision par essence et révolutionner cette séquence pour en faire un investissement et non plus un coût. Procéder ainsi, c’est rompre avec un découplage trop binaire entre le temps de la décision et la décision elle-même, car c’est une phase où beaucoup se révèle et se découvre progressivement. Le temps de la réflexion doit donc être appréhendé comme une séquence large, ce n’est pas un temps perdu, mais un processus continu qui s’étend sur une ample séquence. La décision est ainsi le fruit d’un processus, d’une réflexion et ne se résume pas au spasme décisionnel de l’action. N’en doutons pas, en temps de crise tout particulièrement, pour décider de façon fiable, il devient déterminant de savoir gérer le temps long de la prise de décision.
Le champ de l’action publique n’échappe pas à cette logique et à ces principes. Or, on oublie trop souvent, que ce soit pour des raisons financières, industrielles liées aux équipements, mais aussi d’instruction et de formation, que les décisions prises aujourd’hui auront un effet dans dix ans, vingt ans ou plus. En effet, à l’immédiateté du temps des marchés financiers qui animent tant l’homo economicus du temps présent, ne peuvent s’ajuster ni le temps politique, ni celui diplomatique, et encore moins celui de la posture stratégique, sans parler de celui de la commande publique, fragmentés par les cadencements électoraux et les cycles budgétaires. Le traitement des questions de sécurité sanitaire nationale parait alors de plus en plus en rupture avec la pression de temps asynchrones plus générateur de dysfonctionnements que de synergies. Il convient dès lors de renouveler nos interrogations sur les liens entre décisions politiques, opinions publiques et savoirs scientifiques.
La difficulté devient alors la mise en œuvre simultanée d’actions inscrites sur des temps différents, qui doivent être combinés. Dans ces conditions nous le constatons, en régime démocratique, la chose publique est fréquemment mise à mal par des temporalités politiques éreintantes, voire contre-productives. Car celles-ci imposent constamment une obligation de résultat et de visibilité avant d’avoir laissé aux processus économiques et sociaux le temps et le soin d’opérer. Cette confrontation à la temporalité s’opère aussi, bien évidemment, à l’occasion des engagements opérationnels des forces vives de la nation. La « guerre sanitaire » n’échappe pas à cette logique et demeure, en effet, un art du déroulement et du cadencement du temps. Tout décideur, comme tout mélomane, se doit alors d’avoir le sens du tempo : lent pour le temps long, rapide pour le temps court. Sans oublier “les temps morts”, où tout semble inerte, et où cependant, même pour Clausewitz, ardent défenseur de l’action offensive, se trouve le lieu des amorces et des infléchissements. Rien n’est visible, mais le discret travaille et est à l’œuvre. Si avant tout “la guerre est un art simple et tout d’exécution”, c’est aussi un temps durant lequel il convient de rythmer les modes opératoires en les intégrant et les combinant selon des séquences adaptées.
Alors que tout s’inscrit dans la durée, et que vivre c’est accorder à l’avenir un certain statut, comment une société à ce point dispersée et submergée par le temps au point – que l’on pourrait la qualifier de “ chrono dispersive ” – peut-elle engager une réflexion sur le long terme ? A l’heure où nous sommes confrontés aux blocages et aux clivages du temps rigidifié, tout laisse à croire que nous sommes au cœur de mutations anthropologiques et sociétales non abouties.
François NAUDIN – Délégué Général de l’ENSAE Alumni